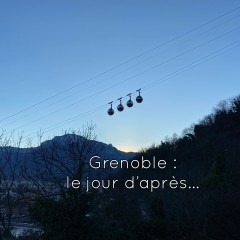Elle nous invite plus que jamais à respecter les consignes, afin que nous puissions sortir au plus tôt de cette situation. Mais elle nous oblige également à nous poser la question de cet après, qui ne pourra être la suite logique de ce que nous avons laissé avant.
La crise du "Covid 19" n’a rien à voir avec les nombreux événements évitables ou non, que nous avons vécu ces dernières années.
Après le 11 septembre, la Guerre en Irak, le tsunami dévastateur dans l’Océan Indien en décembre 2004, la crise économique mondiale en 2008, le début du Printemps Arabe le 18 décembre 2010, les accidents nucléaires à Fukushima en mars 2011, les attentats de Madrid en mars 2004, de Londres en juillet 2005, d’Anders Breivik en Norvège en juillet 2011, de Boston en mars 2013, de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, du Bataclan le 13 novembre 2015, de Bruxelles le 22 mars 2016, d’Istanbul le 28 juin 2016, du 14 juillet 2016 à Nice, etc... nous nous sommes toutes et tous dit que l'on ne pourrait pas faire les choses de la même façon. Comme après chaque événement dramatique, une remise en cause profonde de nos fondamentaux sociaux, de nos échelles de valeurs et de notre mode de production se pose.
Alors, allons-nous continuer à faire comme d'habitude, ou allons-nous enfin utiliser cette crise et les enseignements des précédentes, comme une possibilité de réformer enfin nos rapports et nos fonctionnements ?
S’inquiéter aujourd’hui d'une réorganisation probable et intégrale d'un scrutin, peut paraître éloigné des préoccupations actuelles. Mais plus que jamais, ce manque d’anticipation et de réaction, créé un risque réel pour nos démocraties. Pris dans cette crise d’ampleur, nous voyons comment certains sont tentés de déconsidérer la démocratie locale et certaines libertés publiques. Nous ne pouvons accepter cette morgue vis à vis de l'échelle communale, foulée et galvaudée par certains professionnels de la politique, comme une annexe que l’on pourrait repousser à plus tard.
Si nous continuons à vouloir faire comme d'habitude, nous sortirons de cette crise encore plus dévastés et brisés. Socialement, humainement et économiquement, faute d'introspections et d’outils pour relancer notre modèle de société.
Si nous reconnaissons les faiblesses de nos gouvernances, les insuffisances de nos institutions, et si nous avons le courage de les corriger en responsabilité, nous sortirons plus forts et plus déterminés que jamais.
L'image d'une population rassemblée, telle une grande famille, figure en toutes lettres parmi les principes de notre Constitution qui évoque clairement que « La France est une République indivisible...»
L'union doit s'exprimer par des politiques et des actes au local comme au national conformes à notre volonté d'unité.
La vie démocratique et son expression, doit restée notre meilleur atout, même si le climat actuel nous confirme qu'une vision à long terme est difficile, tant on gouverne aux résultats de sondages, aux baromètres d’opinions et aux mouvements créés sur les réseaux sociaux.
Aveuglés par une certaine surestime d'un soi illusoire, elles et ils au local comme au national, sont incapables d’expertiser la chute d'un monde et de changer leurs prismes, afin de rassembler le plus grand nombre, au-delà des appartenances, et cela pour mieux agir.
Aujourd’hui, il nous faut renverser la table, et retrouver le sens de l’intérêt général, en cessant ces conflits d’intérêts et ces copinages.
Une parole publique est à réinventer. Les gouvernances de demain ne doivent plus confondre communication et information, parce que la confiance ne se décrète pas ; elle se mérite.
C'est donc par ces initiatives locales, loin des grands sermons et des longues théories, que nous commencerons modestement à imaginer ce que nous voulons aujourd'hui pour demain.